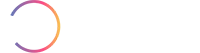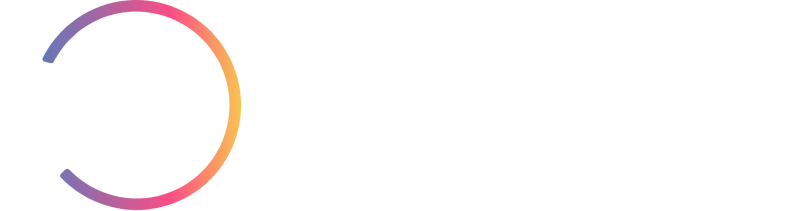Réduction des méfaits: est-ce une incitation à la consommation?
C’est une question qu’on entend souvent dans les festivals et autres événements auxquels on participe. Parfois on peut aussi nous dire qu’on banalise la consommation, qu’on rend ça not a big deal. Ce sont des inquiétudes que plusieurs ont et cet article est là pour clarifier les objectifs de notre approche et pour expliquer sa raison d’être. Nous allons clarifier autant son historique, sa définition que les principes qui l’orientent.
Historique et définition
Cette approche vise à réduire les risques associés à un comportement donné, donc les méfaits qui en découlent généralement. Pour le GRIP, ces comportements sont généralement la consommation et la sexualité, mais le même principe peut être appliqué à la santé auditive, en distribuant des bouchons, mais aussi avec la conduite automobile en instaurant des limites de vitesse ou le port obligatoire de la ceinture.
La question à se poser est :
Est-ce réaliste de penser qu’on fera disparaître ce comportement? Sinon, comment est-ce qu’on peut réduire les risques qui y sont associés, plutôt que de supprimer le comportement en soi?
L’approche de la prohibition tentait de gérer le comportement qu’elle jugeait problématique en le décourageant complètement, notamment avec la War on Drugs. Par contre, de grands défis de santé publique comme la crise du VIH ou la crise des opioïdes finissent par montrer que lorsqu’il y a répression, les gens finissent par consommer mais en cachette, ce qui exacerbe ces mêmes risques qu’on essayait de réduire.
Pour le GRIP, la stratégie de base de la réduction des méfaits (RDM) est l’accès à l’information neutre et basée sur des données probantes, pour ainsi permettre aux personnes une prise de décision éclairée et autonome.
Les grands principes
Pragmatisme
Plutôt que de se demander ce qui est optimal, il faut plutôt viser ce qui est réaliste pour la personne qu’on veut aider. On veut donc approcher le problème en pesant les coûts et bénéfices des différentes options qui s’offrent à elle pour ainsi maximiser son bien-être. Ceci nous mène donc à tolérer le comportement plutôt que le réduire à tout prix.
Avec le cannabis, ça pourrait être de fumer moins souvent, fumer après le travail plutôt qu’avant, ou choisir un cannabis plus faible en THC.
Humanisme
Au lieu de présenter à la personne une seule option pour améliorer sa situation, on lui présente un éventail de choix, pour qu’elle puisse choisir ce qui s’adapte le mieux à sa réalité. On veut donc redonner du pouvoir à la personne en la prenant là où elle est dans sa relation avec la consommation. En reprenant l’exemple du cannabis, on présentera une multitude de choix à la personne en l’impliquant dans la décision et en la responsabilisant, plutôt que de lui imposer une direction qu’on jugerait correcte, comme arrêter de fumer si la personne fume régulièrement depuis des années.
Bas seuil/accessibilité
On veut adapter nos services à la réalité de notre clientèle et à son environnement pour le rendre le plus approchable et accessible. Ça implique notamment d’avoir un kiosque visible dans un milieu festif ou de ne pas demander une carte RAMQ pour accéder à l’analyse de substances.
Conséquences
On promeut les moyens concrets pour réduire les conséquences du comportement. Par exemple, on peut distribuer de la naloxone et expliquer son fonctionnement pour prévenir les surdoses mortelles d’opioïdes, ou distribuer des sniff kits ou des condoms pour réduire les risques d’infection.
Programmes et politiques
Finalement, ces actions doivent être appuyées par des politiques publiques qui les facilitent. La décriminalisation de possession simple, les exemptions légales pour les services d’analyse de substances ou les initiatives de récupération de matériel de consommation en font toutes partie.
Conclusion
En fait, à la lumière de ces principes, ce qui donne un vrai avantage à la réduction des méfaits, c’est qu’elle envoie le message à notre clientèle qu’on ne la juge pas, qu’on la comprend et qu’on est prêt.e.s à respecter son choix, quel qu’il soit.
On ne se positionne pas comme expert.e dans l’intervention, mais comme aidant.e. On accompagne la personne dans son processus en reconnaissant qu’elle éprouve aussi des aspects positifs à sa consommation et du plaisir, ce qui nous permet ultimement de créer une relation de confiance.
Vous pouvez maintenant aller consulter notre site sur la loi de l’effet pour connaitre les stratégies concrètes que VOUS pouvez mettre en place pour réduire les risques avec VOTRE consommation!